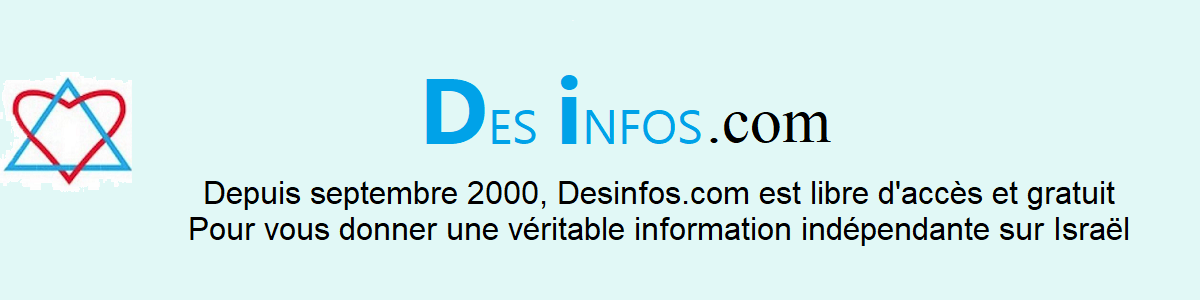Dans notre récent point de vue du 11 décembre 2004, nous voulions simplement atténuer l’impression par trop optimiste diffusée par certains médias israéliens, à propos de travaux menés aux Nations Unies portant, notamment, sur le terrorisme.
De ce fait, par suite d’un manque de place, nous avons passé sous silence une prise de position, non moins récente, du Conseil de sécurité sur cette question.
En effet, dans sa résolution 1566, adoptée le 8 octobre dernier, cet organe principal des Nations Unies a, certes, réaffirmé de précédentes résolutions concernant les menaces que le terrorisme fait peser sur la paix et la sécurité internationales.
Mais, ce qui est nouveau c’est que, sans prétendre, pour autant, donner une définition de ce fléau moderne, les 15 membres du Conseil de sécurité, parmi lesquels figurent notamment le Pakistan et l’Algérie, ont, à l’unanimité, donné une approche du terrorisme auquel le Groupe de personnalités de haut niveau, dont nous avons relaté les travaux s’est tout naturellement référé.
Contrairement à l’impression que les membres du Conseil de sécurité ont voulu donner, cette résolution ne « rappelle » pas cette approche du phénomène, car, précédemment, le Conseil s’était borné à le condamner, sans le définir.
Cette fois, le Conseil indique que « les actes criminels, notamment ceux dirigés contre des civils dans l’intention de causer la mort ou des blessures graves ou la prise d’otages dans le but de semer la terreur parmi la population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s’abstenir de le faire, qui sont visés et érigés en infractions dans les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, ne sauraient en aucune circonstance être justifiés par des motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou similaire et demande à tous les Etats de prévenir ces actes, et, à défaut, de faire en sorte qu’ils soient réprimés par des sanctions à la mesure de leur gravité ».
Jamais, à notre connaissance, le Conseil de sécurité qui, il faut le rappeler, a « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » (article 24 de la Charte) n’était allé aussi loin.
Mais cette prise de position est encore insuffisante.
Certes, la résolution 1566 a bien été prise sur la base du Chapitre VII de la Charte, qui, reconnaît au seul Conseil de sécurité un pouvoir de décision, voire de sanction, mais, en l’espèce, elle se borne à émettre une « demande » adressée aux Etats.
Cette formulation n’a donc aucun effet concret par lui-même.
Il reste, encore, à mettre en place un mécanisme qui serait de nature à permettre, à défaut d’une prévention, une répression de tels actes.
Or, la Cour pénale internationale, opérationnelle depuis 2002, n’a pas compétence en matière de terrorisme.
Et sur le plan universel, à la différence du plan européen, la procédure d’extradition (c’est à dire l’obligation de livrer raison une personne présumée avoir accompli une infraction sur le territoire de l’Etat qui la réclame) peut ne pas s’appliquer sur la base de certaines conventions régionales ou interrégionales.
Ainsi, par exemple,la convention de la Conférence islamique de lutte contre le terrorisme international (1999) confirme « la légitimité du droit des peuples à lutter contre l’occupation étrangère ».
Or, cette exception à l’engagement de lutter contre le terrorisme international pourrait se fonder sur l’avis consultatif émis par la Cour internationale de justice le 9 juillet 2004, considérant, sans pour autant se justifier, qu’Israël occupe « la Palestine ».
Aussi, nous ne pouvons que confirmer notre scepticisme quant à la volonté des Nations Unies de lutter contre le terrorisme international, sous toutes ses formes.
- David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit international